M’outiller
Les points repris ci-dessous sont des outils : ils sont avant tout là pour vous aider (en tant qu’étudiant·e·s en journalisme, journalistes et professionnel·le·s des médias) à intégrer plus d’égalité et de diversité au sein de vos productions médiatiques. Ils sont le versant « pratique » de Studentalia.
Sentez-vous libre d’y revenir aussi souvent que vous le souhaitez et de les incorporer progressivement à votre pratique journalistique. Pour aller plus loin, le site de l’AJP compile l’ensemble de nos études et recherches.
Ressources de l’AJP

La base de données Expertalia
Expertalia.be est un outil créé par l’AJP et destiné aux journalistes et aux étudiant·es en journalisme et communication. Cette plateforme vise à promouvoir la diversité dans les médias : avec un critère d’égalité (davantage de femmes) et de diversité (davantage de personnes issues de la diversité d’origine).
Ce site a été créé pour un usage double :
- Pour les journalistes et les étudiant·es, en leur apportant un outil supplémentaire destiné à faciliter la pratique quotidienne de leur métier ;
- Pour les expert·es, en leur donnant une meilleure visibilité dans le paysage médiatique.

Informer sur les thématiques LGBTQIA+ : recommandations et lexique à l’attention des journalistes, AJP, septembre 2023
Nos écrits, nos sons, nos images, ont des répercussions réelles, parfois violentes, sur le quotidien des personnes LGBTQIA+. Outiller adéquatement les journalistes et étudiant·e·s en journalisme est donc une nécessité. L’AJP, la RainbowHouse Brussels et l’Association pour la Diversité et l’Inclusion dans les Médias se sont penchées sur le traitement médiatique des thématiques LGBTQIA+.
Les recommandations présentées ici se veulent une base de réflexion sur nos pratiques, mais elles ne prétendent pas cependant être définitives, inscrites dans le marbre. Dans une optique de bonnes pratiques assurées sur le long terme, n’hésitez pas à vous (in)former auprès d’associations de personnes concernées et spécialisées sur les thématiques LGBTQIA+, afin de garantir une information la plus à jour possible.
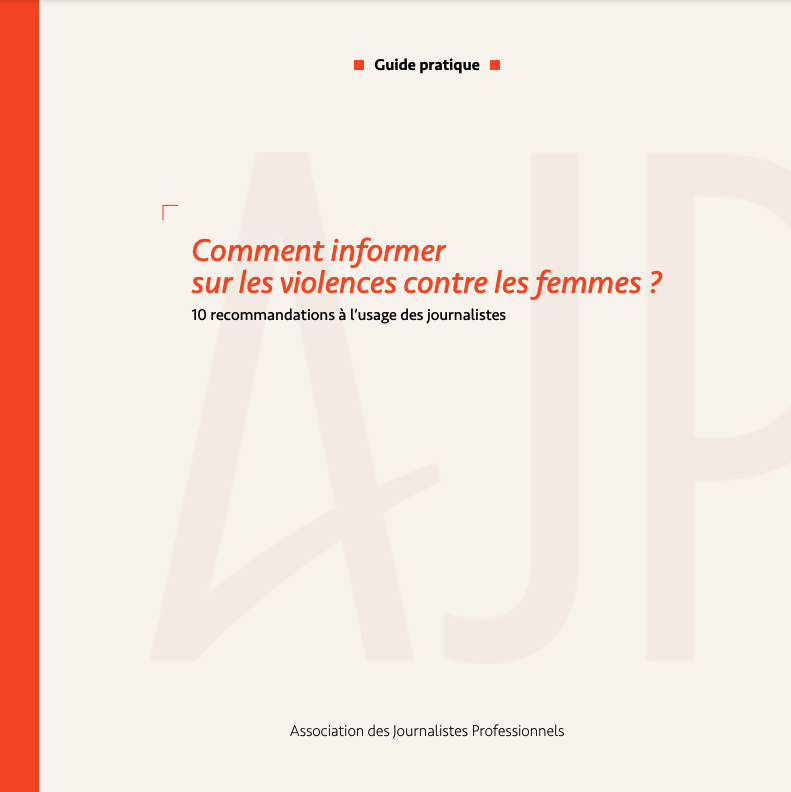
Comment traiter les violences faites aux femmes ? 10 recommandations à l’usage des journalistes, AJP, 25 novembre 2021
Ce guide pratique à destination des journalistes a pour ambition d’éclairer les enjeux de la violence systémique contre les femmes. Il comporte 10 recommandations en 10 fiches, portant sur le choix des termes à employer, des illustrations adaptées, la relation aux victimes, les angles pertinents…
Le guide contient également de nombreux exemples de bonnes et moins bonnes pratiques journalistiques, un rappel de la législation et de la déontologie, un lexique et plus d’une centaine de références bibliographiques. Cet ouvrage s’accompagne de la vidéo « Comment BIEN parler des violences contre les femmes ? » (21/12/2021)

Étude de la diversité et de l’égalité dans la presse quotidienne belge francophone (2024)
Pour cette quatrième édition, six quotidien (Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports+, L’Écho, La Meuse et L’ Avenir) ont été analysés, soit un échantillon de 1.323 articles, 14.659 intervenant·e·s, sur 5 axes (genre, origine, âge, catégorie socioprofessionnelle et handicap). L’étude montre peu de progrès significatifs, de la stagnation sur quasi tous les critères par rapport aux études menées en 2018, 2014 et 2011, voire même quelques régressions.
Retrouvez déjà quelques résultats sur la page d’accueil de Studentalia !
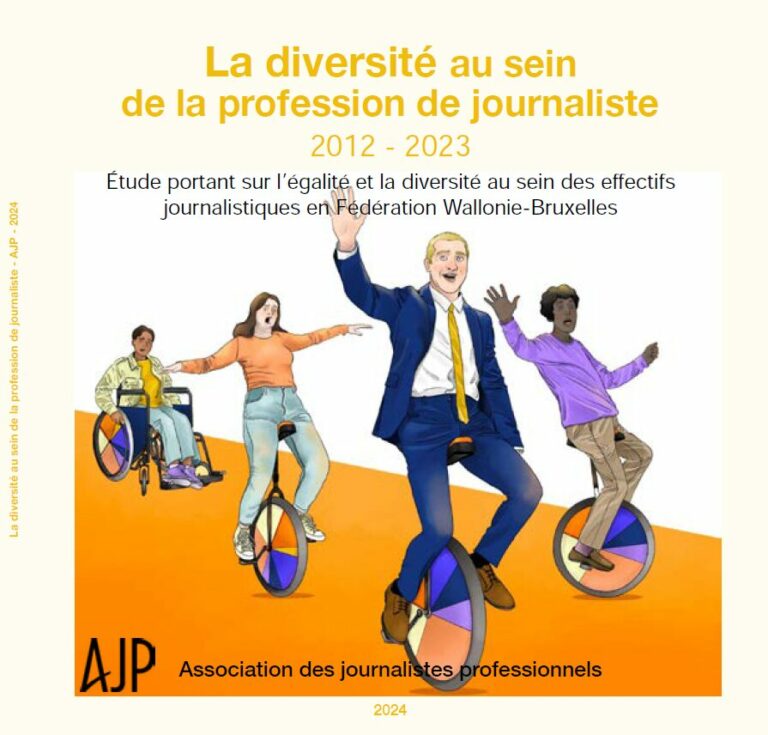
La diversité au sein de la profession de journaliste (2012-2023). Étude portant sur l’égalité et la diversité au sein des effectifs journalistiques en Fédération Wallonie-Bruxelles (2024)
Le journaliste type ? Un homme universitaire blanc de 47 ans, Belge, dont la langue maternelle est le français et dont les parents sont belges. Un portrait qui n’a quasiment pas évolué en dix ans, ce qui pose des questions en termes de pluralisme et de reflets de la diversité au sein de la société belge francophone.
Mais au-delà de ce portrait-robot, quelle diversité présente la « population » journalistique en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Cette étude de l’AJP, en collaboration avec l’Observation de recherches sur les médias et le journalisme de l’UCLouvain (ORM), révèle des dynamiques contrastées. Si la profession a connu certaines évolutions positives au cours de la dernière décennie, ces progrès restent limités et inégaux, notamment en termes d’inclusion (et de rétention) des profils féminins et issus de la diversité d’origine et culturelle.
Les défis à relever pour une meilleure inclusion des femmes, des personnes issues de minorités culturelles et sociales, ainsi que des personnes en situation de handicap, demeurent nombreux et doivent être pensés au-delà du moment de l’entrée dans la carrière, pour que les efforts de recrutements puissent avoir un réel impact sur la longue durée sur l’évolution des profils présents dans les rédactions.
Les recommandations du CDJ
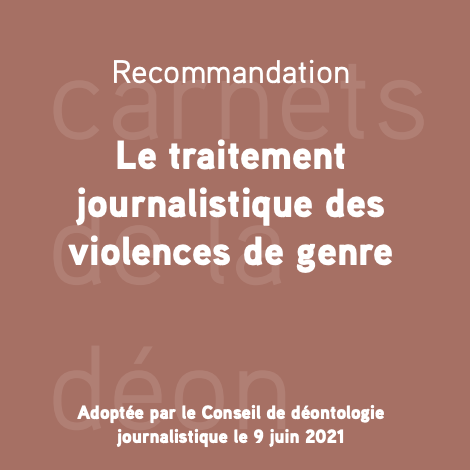
Recommandation sur le traitement journalistique des violences de genre (2021, Conseil de Déontologie Journalistique)
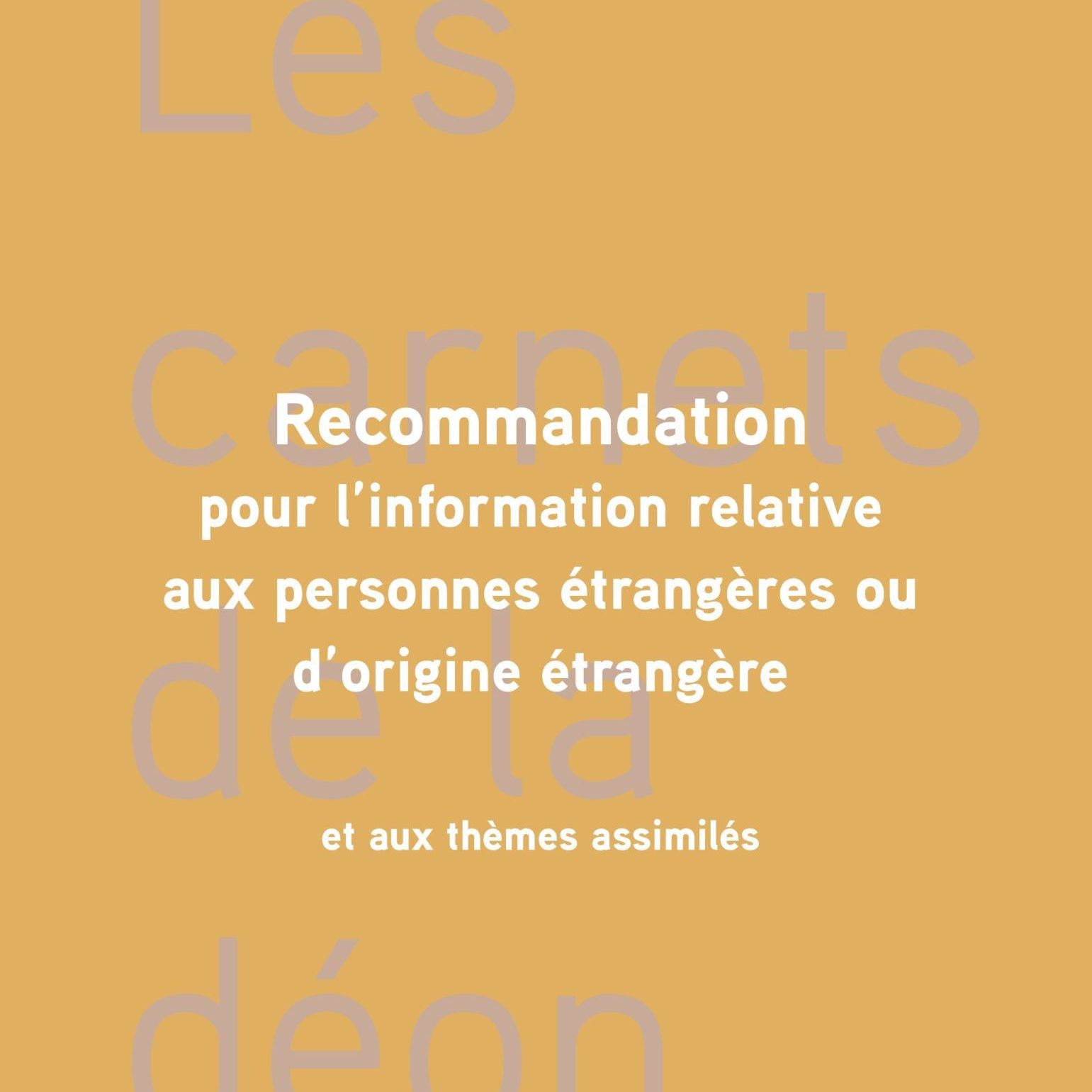
Recommandation pour l’information relative aux personnes étrangères ou d’origine étrangère et aux thèmes assimilés (2016, Conseil de Déontologie Journalistique) :
Les études du CSA

Baromètre Diversité & Égalité – 10 ans, CSA, 2021
Le Baromètre du CSA est un état des lieux de la place et de la représentation de l’égalité et la diversité dans les médias audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la lumière des critères de genre, d’origine, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de handicap. Avec ce nouveau Baromètre sur des données récoltées en 2021, il s’agit de la cinquième édition portant sur les services télévisuels depuis sa première réalisation en 2011.
Les constats dressés dans cette édition historique témoignent de peu d’évolutions en matière d’égalité et de diversité à l’écran.
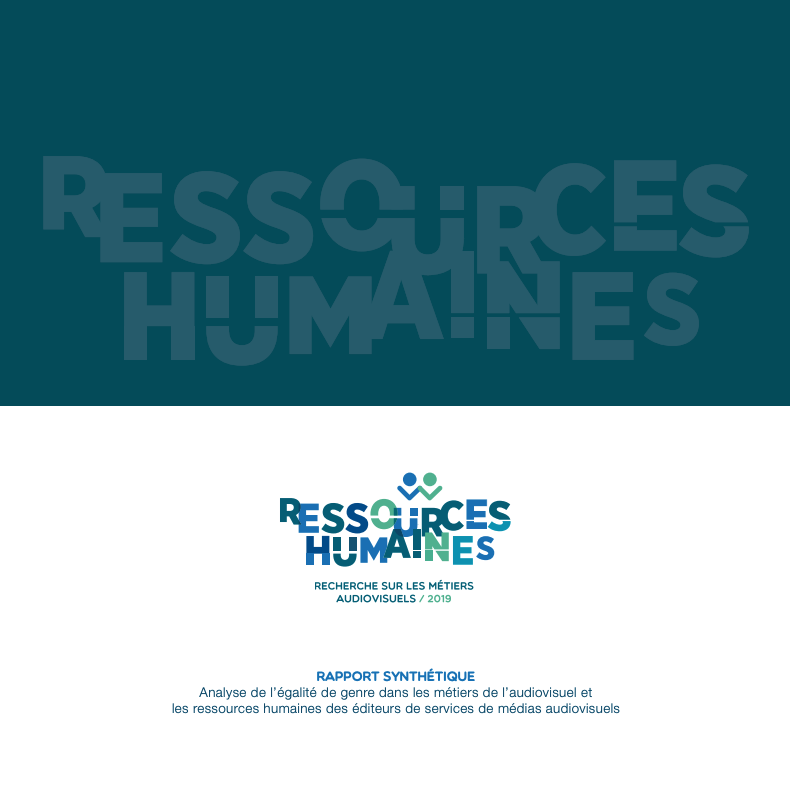
L’égalité de genre dans les métiers de l’audiovisuel (29/10/2020)
Cette recherche vise à apporter des informations sur la distribution globale des hommes et des femmes dans les services de médias audiovisuels, sur leurs emplois et taux d’occupation respectifs, sur leur distribution dans les postes hiérarchiques ainsi que dans les familles de métiers de l’audiovisuel.

Journalisme audiovisuel belge francophone : minorités visibles, discriminations invisibles, mémoire de fin d’étude de Hanan Harrouch, présenté sous la direction de Florence Le Cam en vue de l’obtention du titre de Master en Journalisme, Université Libre de Bruxelles (2018-2019)
Il s’agit d’une recherche approfondie autour de l’expression « minorités visibles » et des difficultés qu’ils·elles peuvent rencontrer dans leur carrière de journaliste. Ce travail dresse les portraits et les parcours de ces journalistes issu×e×s des minorités visibles, attire l’attention sur la question des femmes journalistes issues de minorités visibles et pointe du doigt la quasi-totale absence des personnes noires dans le journalisme audiovisuel.
Lexiques et glossaires
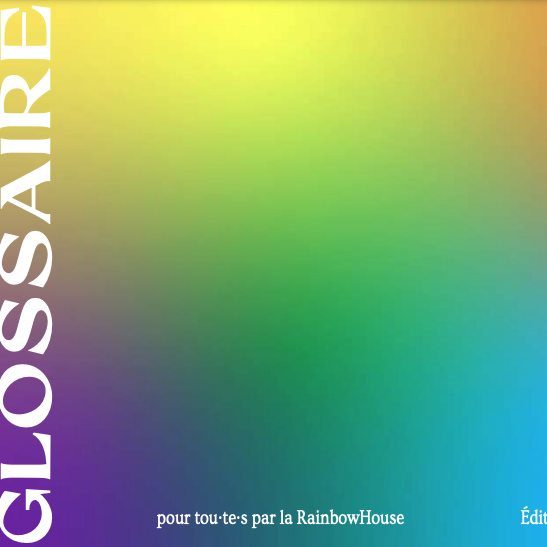
Le Glossaire de la Rainbow House Brussels (2020)
La Rainbow House Brussels regroupe une cinquantaine d’associations LGBTQIA+ multilingues de la Région Bruxelles-Capitale. Elle se définit comme un espace safe et inclusif. Elle a notamment publié un glossaire, non exhaustif, dans le but d’aider à comprendre les réalités que peuvent englober certains mots en donnant des définitions les plus simples possibles afin qu’elles puissent être comprises par le plus grand nombre.

Lexique de termes décoloniaux, CNCD 11.11.11 (11/12/2020)
Constitué par le CNCD 11.11.1, ce lexique offre une vision claire sur les termes les plus utilisés lorsqu’on s’intéresse aux questions de décolonisation et de diversité. Ce lexique non exhaustif vise une meilleure compréhension de certains concepts de plus en plus utilisés pour désigner les rapports de domination, d’exclusion, de stigmatisation dont sont victimes les personnes issues de la diversité d’origine.

Glossaire des termes journalistiques concernant les personnes étrangères et issues de l’immigration
Ce guide pratique donne un éclairage sur le sens exact des mots, d’expressions et de noms d’institutions dont l’occurrence est fréquente dans le discours journalistique lorsqu’il s’agit de personnes étrangères ou issues de l’immigration. Ce glossaire propose notamment des usages standardisés pour établir une plus grande homogénéité d’interprétation et réduire les risques d’ambiguïtés, d’approximations ou d’amalgames dans l’information sur ces sujets.
Sur le genre
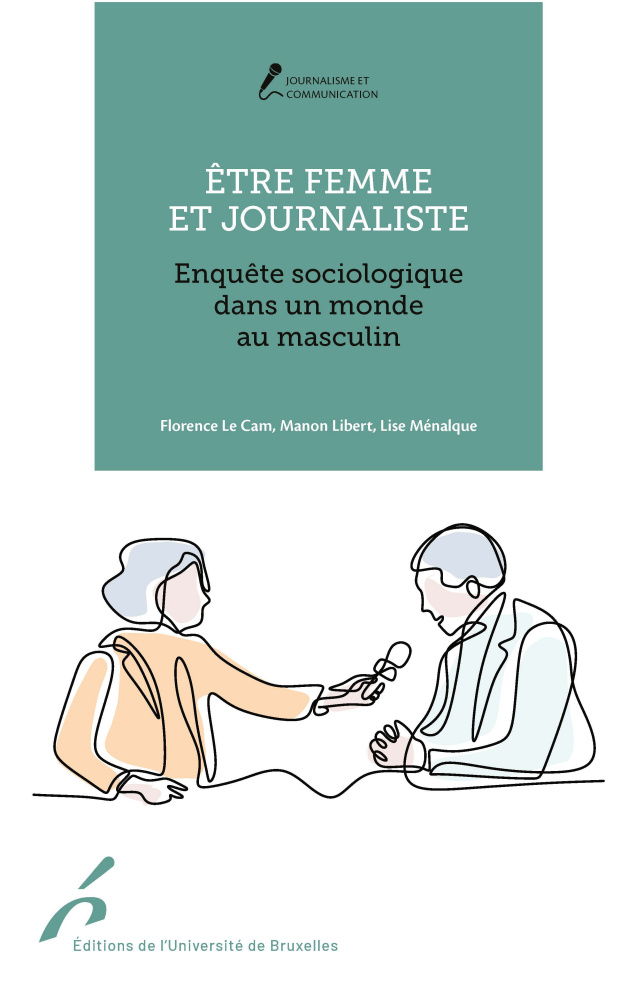
Être femme et journaliste. Enquête sociologique dans un monde au masculin, 25/11/2021, Florence Le Cam, Manon Libert et Lise Ménalque, Éditions de l’Université de Bruxelles (25€)
En Belgique francophone, le journalisme se vit encore majoritairement au masculin. Les femmes ne représentent qu’un tiers des journalistes titulaires de la carte de presse, alors qu’elles sont majoritaires dans les formations en journalisme. Ce livre interroge alors le rôle et la place des femmes journalistes au sein des entreprises médiatiques.
Les résultats de cette enquête sociologique détaillent un cocktail professionnel qui entrave la féminisation : plafond de verre, assignation genrée à certaines rubriques et violences organisationnelles.
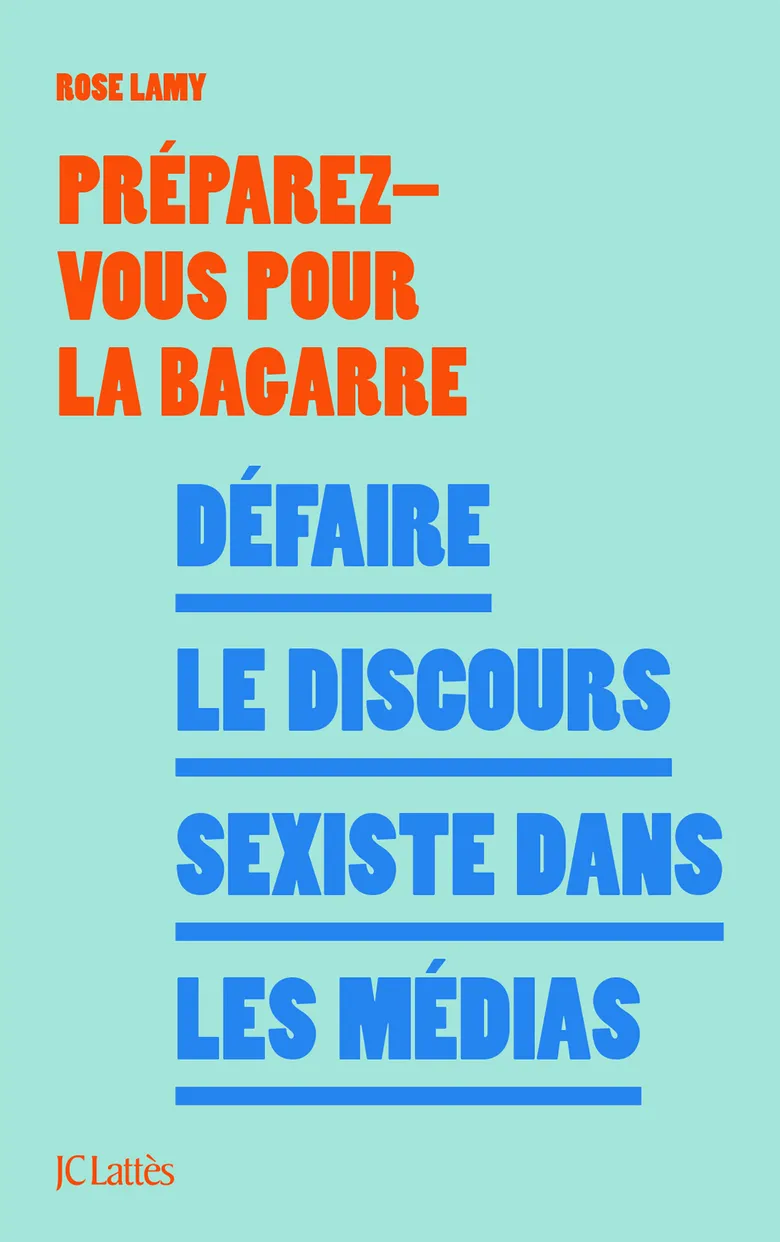
Défaire le discours sexiste dans les médias, Rose Lamy (Préparez-vous pour la bagarre), JC Lattès, 10 novembre 2021 (19€)
Dans cet ouvrage, l’autrice décortique des centaines d’exemples d’un discours sexiste dans la presse, à la télévision ou à la radio française, qu’elle a collecté pendant trois ans. Il a pour but d’explorer les fondements de ce discours sexiste, de pointer du doigt certains choix de mots, pour en défaire les mécanismes. En effet, ce sexisme conduit les rédactions à taire ou à reléguer les violences sexuelles en périphérie des journaux, il participe à la culpabilisation des victimes et à la déresponsabilisation des accusés.

Projet Nellie Bly (4 épisodes), un podcast d’Axelle Magazine sur le traitement des violences médiatiques envers les femmes / webinaires à destination des étudiant·es en journalisme et professionnel·les de l’info : Série Le projet Nellie Bly – Axelle Mag
- Femmes journalistes face au sexisme
- “J’ai besoin d’une femme battue pour demain.”
- L’intersectionnalité, une loupe journalistique
- Sujets féministes, soupe raciste

Quelle médiatisation des violences ?, l’Université des femmes, Chronique féministe n°127, janvier-juin 2021 (9,50€)
La Chronique féministe est la revue semestrielle de l’Université des Femmes. Elle se compose d’un dossier thématique, d’articles sur l’actualité féministe et de comptes rendus de lectures.
Ce numéro contient le dossier « Vers un juste traitement médiatique des violences faites aux femmes dans les médias : avec quels travers ? » de Camille Wernaers, le dossier « Violences faites aux femmes : comment transformer les pratiques journalistiques ? » de Manon Legrand, ou encore le dossier « Des crimes contre la moitié de l’humanité. Comment en parler dans les médias ? » d’Anne-Marie Impe.
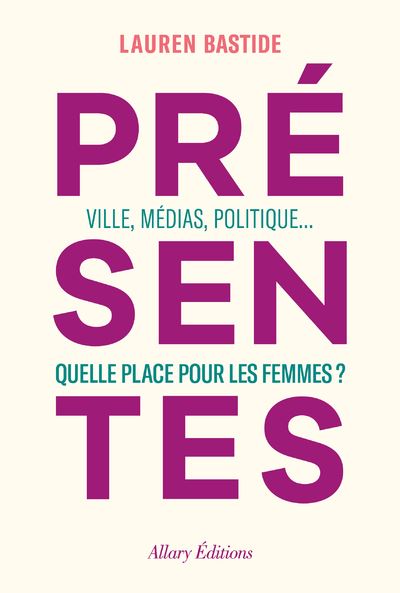
Présentes : villes médias, politique… quelle place pour les femmes ?, Lauren Bastide, Allary Éditions, 3 septembre 2020 (19,90€)
Présentes pointe du doigt la sous-représentation des femmes dans tous les espaces et les médias, elles sont minoritaires partout. Lauren Bastide signe ainsi un manifeste féministe, qui donne la parole aux femmes pour mettre en lumière les réflexions des militantes d’aujourd’hui.
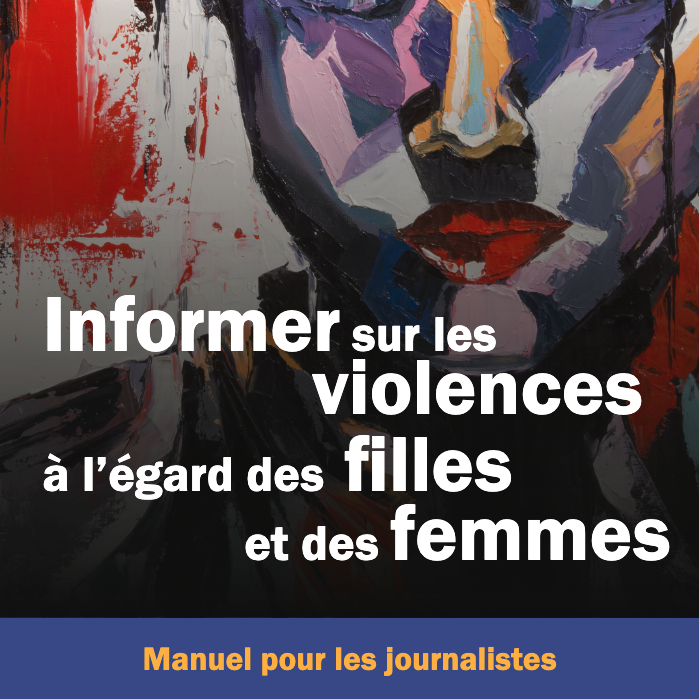
Informer sur les violences à l’égard des filles et des femmes: manuel pour les journalistes (2019, Anne-Marie Impe, UNESCO)

Sexisme, médias et société, Cécile Goffard, Média Animation et RTBF, novembre 2019
À la demande de la RTBF, cette publication rédigée par Media Animation décrypte le sexisme sous trois angles : la société, le monde du travail et les médias. Tout au long de cette brochure, des exemples illustrent la manière dont les inégalités se matérialisent dans notre société, le monde du travail et les médias, notamment le journalisme. Ces exemples sont accompagnés de concepts pour mettre à nu la mécanique sexiste et nommer les inégalités. Enfin, la brochure met en avant des initiatives de militant·e·s et de professionnel·le·s des médias, des liens pour aller plus loin et des pistes de réflexion, pour combattre le sexisme dans toutes ses dimensions.

“Mettre au féminin” – Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre (2014, Marie-Louise Moreau et Anne Dister, Fédération Wallonie-Bruxelles)

Prenons la Une
Prenons la Une est une association de journalistes qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias et l’égalité dans les rédactions. Ses membres participent à la mise en place d’actions concrètes pour atteindre cet objectif en cohérence avec les règles déontologiques du journalisme. Elles organisent des événements, rédigent des tribunes, interviennent dans des écoles, recherchent des subventions, etc.

GenderStat.be
Initiative de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH), GenderStat est le portail belge des statistiques et indicateurs de genre. Explorez des données sur les femmes et les hommes en matière de travail, revenus, population, santé et bien plus encore.
Sur les communautés LGBTQIA+ et les minorités de genre

LGBTphobies, médias et société, Daniel Bonvoisin, Cécile Goffard, Brieuc Guffens, Clint Delmée, Anna Devroye, Anaïs Montes et Chloé Tran Phu, Média Animation et RTBF, 19 octobre 2022
Pour leur troisième publication commune, Média Animation et la RTBF s’attaque aux LGBTQIA+phobies dans les médias, et notamment dans le journalisme. L’ambition de cette brochure est d’accompagner les industries médiatiques afin que le traitement des thématiques qui concernent les communautés LGBTQIA+ soit à la hauteur des évolutions sociétales et que les identités de chacun·e soient respectées.

LGBTQIA+ : pourquoi le choix des mots est important dans les médias, Les Grenades, RTBF, publié le 12 février 2021
Cet article souligne la nécessité de se documenter et former sur les questions de genre, afin de traiter les sujets LGBTQIA+ de façon pertinente. Il recommande aussi de prendre contact avec des associations LGBTQIA+, directement concernées, pour ne pas commettre d’impairs.
Cet article termine par un lexique, pour palier les mauvaises utilisations de vocabulaire.

Informer sans discriminer : traiter les thématiques LGBT avec justesse et dans le respect des personnes (mai 2021, AJL)
Un kit conçu à l’intention des journalistes et des professionnel×le×s des médias, élaboré et souvent mis à jour par l’AJL, l’Association des journalistes lesbiennes, gays, bi×e×s, trans et intersexes. Il s’agit d’aider concrètement les rédactions à traiter de façon juste, rigoureuse et respectueuse des questions souvent perçues comme délicates et complexes.
En 2015, l’AJL a proposé aux rédactions françaises de signer une charte contre l’homophobie (disponible en suivant ce lien : https://www.ajlgbt.info/charte-les-medias-contre-lhomophobie/). Ce texte de bonnes pratiques journalistiques a pour objectif de garantir une couverture médiatique de qualité des thématiques LGBT.
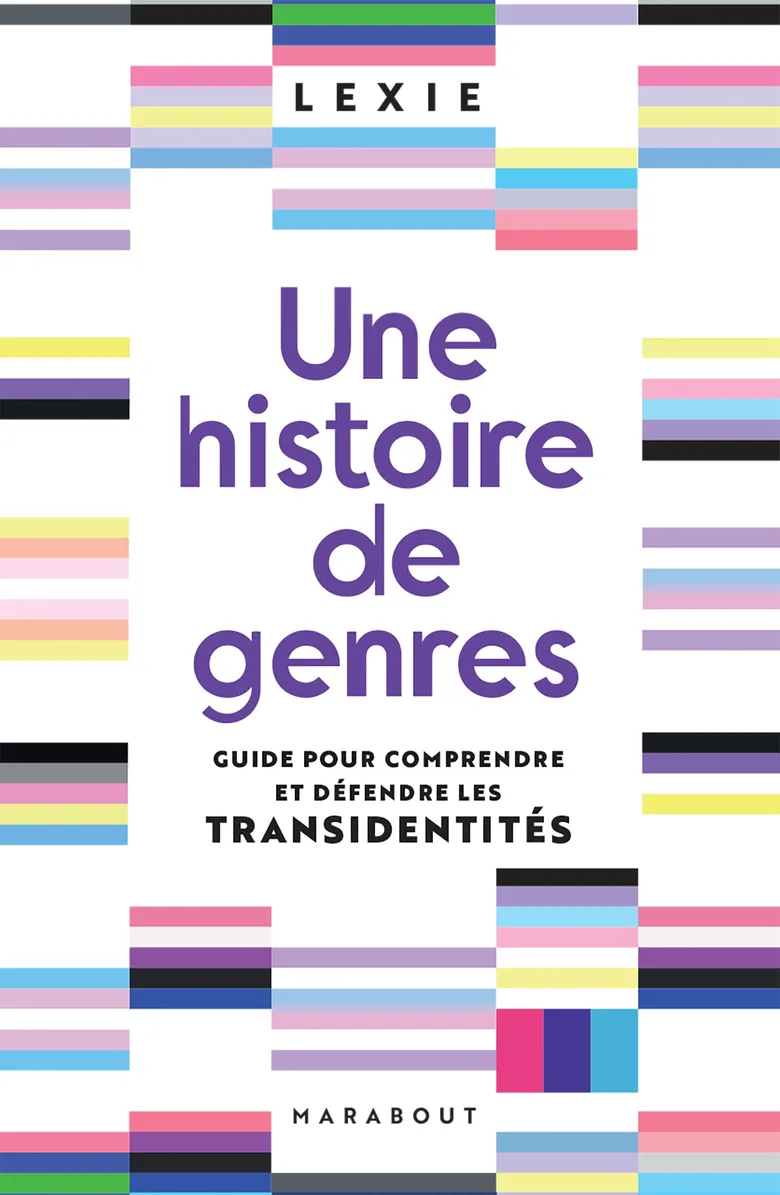
Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les transidentités, Lexie, Marabout, 10 février 2021 (19,90€)
Les questions de genre et d’identité sont de plus en plus présentes dans les médias. Ces questions sont aussi un rapport à des normes et constructions sociales, culturelles et historiques qu’il faut questionner. Ce guide déconstruit les préjugés, les abus de langage, les non-sens liés aux transidentités, afin de mieux les comprendre et de donner des armes pour s’en émanciper.
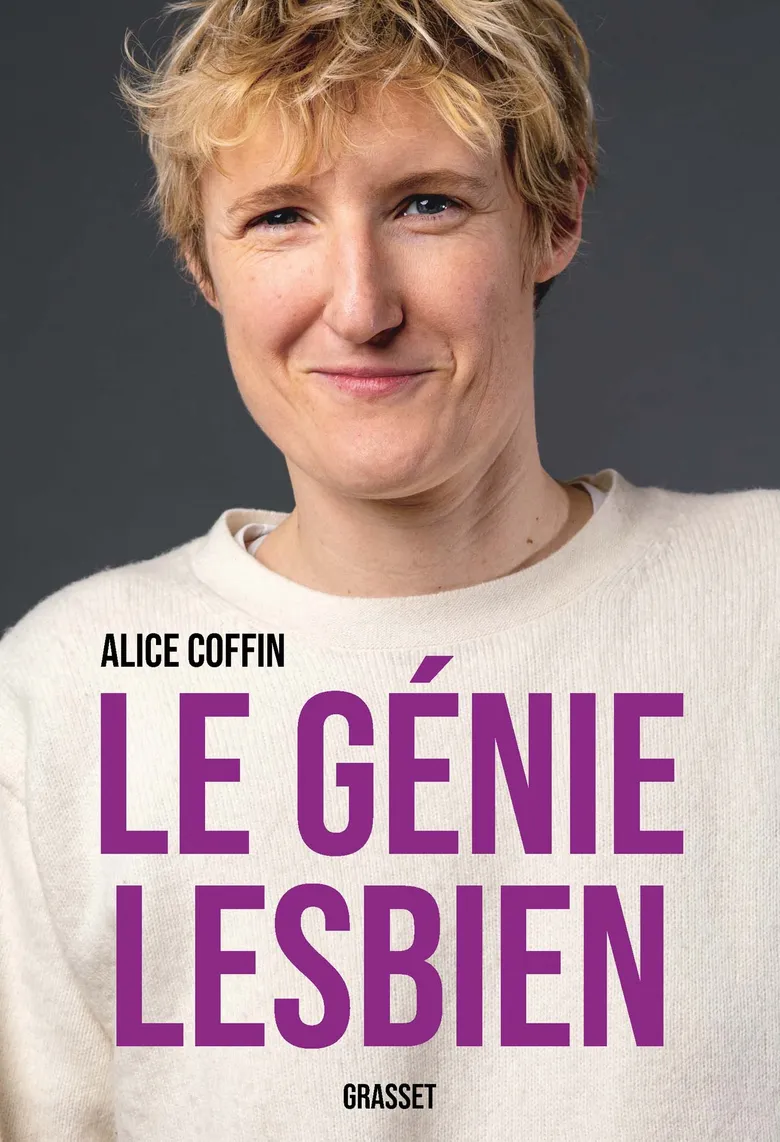
Le génie lesbien, Alice Coffin, Grasset, 30 septembre 2020 (19€)
Dans un essai personnel, Alice Coffin revient sur la notion de neutralité, notamment dans le journalisme. Elle se demande également si le constat posé par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe (1949), « le neutre, c’est l’homme », est toujours d’actualité.
Sur la diversité d’origine

Racisme, médias et société, Daniel Bonvoisin, Cécile Goffard et Brieuc Guffens, Média Animation et RTBF, janvier 2021
Malgré la volonté affichée d’encourager la diversité, les rédactions des médias d’information restent majoritairement blanches. Quel rôle les médias jouent-ils alors dans la reproduction des inégalités ? Permettent-ils au contraire de les réduire ?
Racisme, médias et société est une nouvelle brochure de Média Animation, toujours réalisée avec le soutien de la RTBF. À travers l’analyse critique d’une multitude d’exemples issus des médias populaires, cette étude représente, pour le public, une opportunité d’identifier les routines discriminantes et des leviers d’action pour les endiguer.

Peau noire, médias blancs. Stigmatisation des Noirs et de l’Afrique dans la presse belge et française, Djia Mambu, Kwandika, 2017 (15€)
Cet ouvrage pose la question du rôle des médias en Europe (et plus largement, en Occident) par rapport à la perception sur les minorités visibles établies en Europe. À travers une centaine d’exemples puisés essentiellement dans la presse belge et française, ce livre tente de montrer et démontrer les mécanismes qui s’opère autour des médias occidentaux quand ceux-ci sont amenés à traiter de sujets concernant les Noirs et/ou l’Afrique, afin d’insuffler quelques pistes d’améliorations.
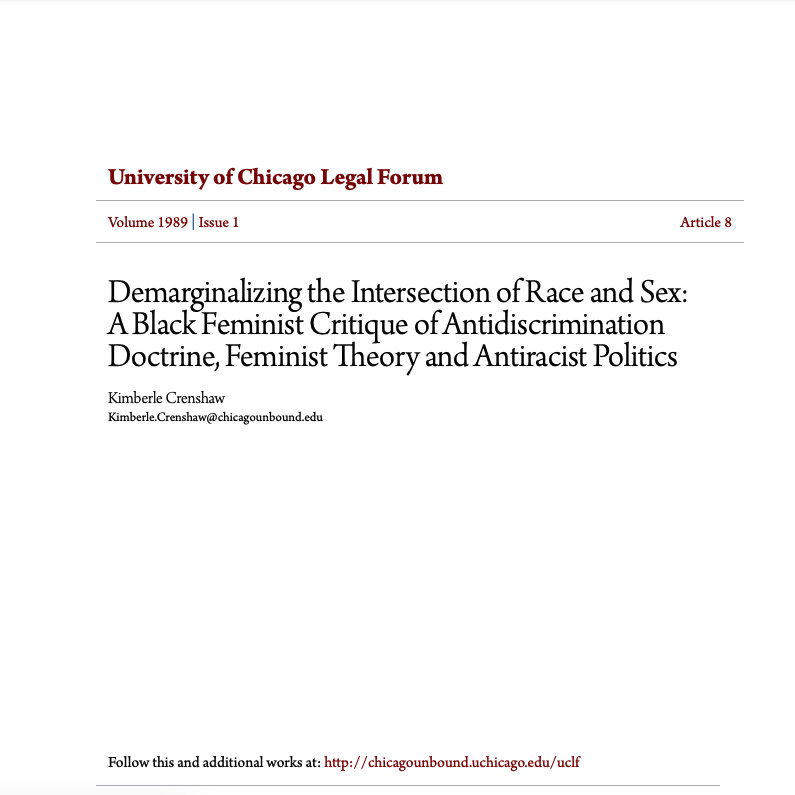
Crenshaw K., “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8
En 1989, dans son article « Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire de la doctrine de l’anti-discrimination, de la théorie féministe et de la politique anti-raciste », la sociologue noire américaine Kimberlé Crenshaw a introduit le concept d’intersectionnalité. Elle livre une étude mettant en lumière de façon concrète les discriminations auxquelles sont sujettes les femmes noires et précaires aux États-Unis.

Association pour la diversité et l’inclusion dans les médias (ADIM)
L’Association pour la diversité et l’inclusion dans les médias a pour but d’assurer que les personnes issues de groupes minorisés aient leur place dans les médias belges d’une part, et d’attirer l’attention sur l’importance d’un système médiatique non homogène d’autre part. Pour atteindre ses objectifs d’inclusion et de représentativité, l’association sensibilise, accompagne et forme les journalistes, rédactions et directions d’entreprises médiatiques.
L’ADIM organise aussi des safe spaces, c’est-à-dire des rencontres entre femmes journalistes dans un cadre bienveillant et sécure, où elles peuvent partager des expériences de travail et leurs besoins en tant que femmes journalistes. Ces rendez-vous prennent en compte la dimension intersectionnelle des journalistes.
Sur le handicap et le validisme

Validisme, médias et société, Daniel Bonvoisin, Brieuc Guffens et Chloé Tran Phu, Média Animation et RTBF, septembre 2024
Le monde mis en scène par les médias belges francophones est pratiquement exempt de personnes en situation de handicap qui représentent pourtant 15 % de la population. Seuls 0,47 % des contenus visibilisent des personnes handicapées. Et quand elles apparaissent, c’est principalement pour « inspirer » les publics valides. S’appuyant sur l’expérience des personnes concernées, cette publication identifie en quoi les industries médiatiques participent à leur marginalisation. Elle espère contribuer à situer la manière dont l’environnement médiatique pourrait œuvrer à leur inclusion authentique et rencontrer leur revendication : « Rien sur nous, sans nous ! »
Cette publication et les messages qu’elle entend adresser à l’univers des médias s’appuient sur de nombreux témoignages de personnes en situation de handicap. Ceux-ci ont été collectés en mai et juin 2024 avec différentes ASBL : Esenca, Altéo et Vis à Vis.
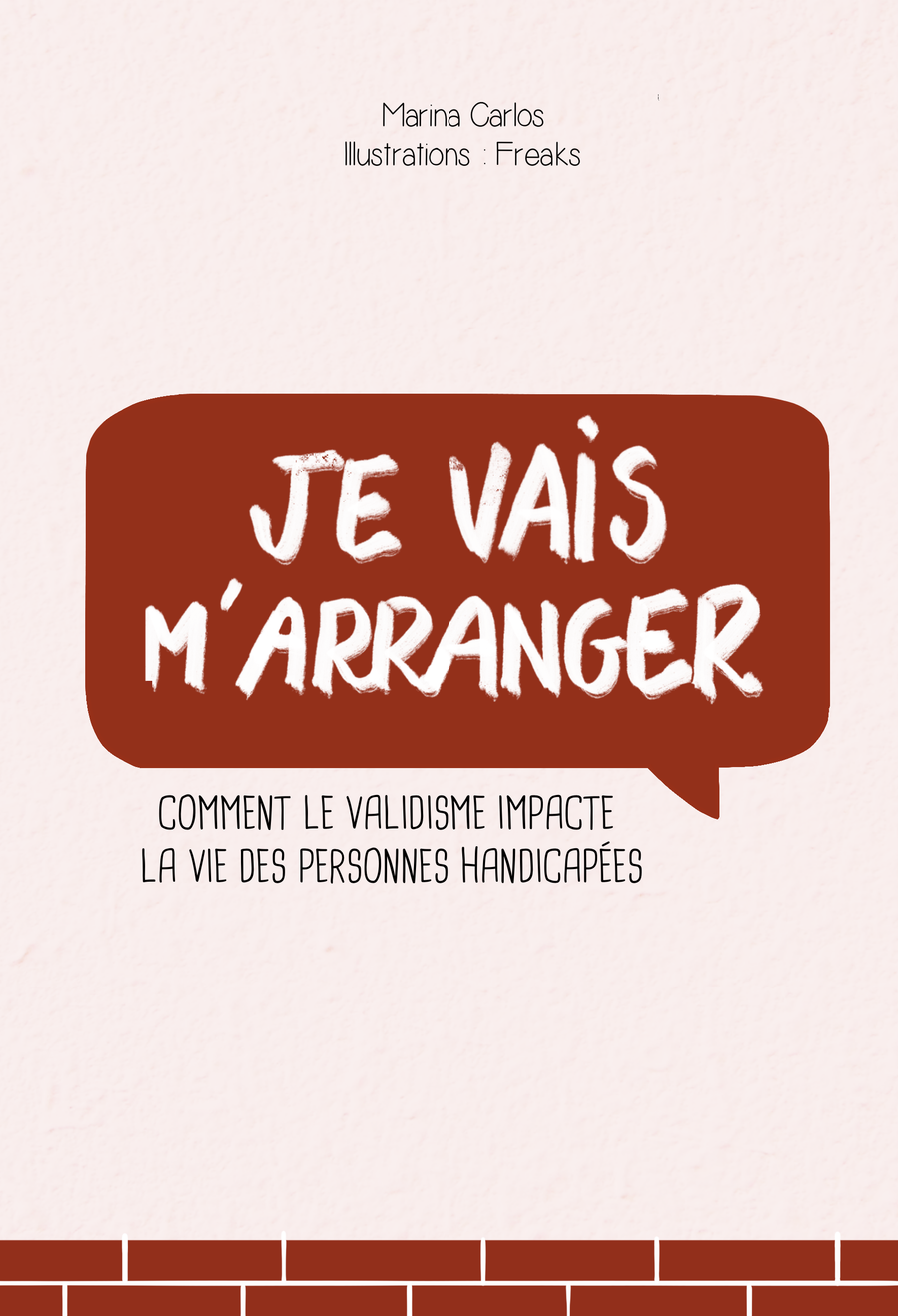
Je vais m’arranger. Comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, Marina Carlos, illustrations de Freaks, 2 juin 2020 (9,90€ version digitale, 14,90€ version papier)
Marina Carlos a autopublié un livre illustré sur le validisme, l’oppression des personnes handicapées. Car vivre avec un handicap, c’est être constamment marginalisé et c’est une réalité vécue des millions de personnes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que plus d’un milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap.
Du manque d’accessibilité à la représentation dérisoire dans les médias, l’ouvrage explore cinq thématiques afin de montrer comment le validisme est constamment présent dans leur quotidien et quelles revendications sont portées par les activistes directement concernés pour atteindre une société plus juste, qui ne laisse personne derrière.

RollingNews – L’information en mouvement
RollingNews est un blog d’informations, fondé par la journaliste Manon Thomas. Elle en est aussi la rédactrice en cheffe et est engagée sur les questions d’équité et à la déconstruction des stéréotypes de genres et validistes.
Les personnes qui collaborent à ce projet le font de manière bénévole. Ce média se veut indépendant dans la liberté intellectuelle et dans son exécution professionnelle.

Les Dévalideuses
Les Dévalideuses est une association visant à représenter les voix des femmes handicapées dans toute leur diversité, tout en contribuant à rendre publiques et à défendre les problématiques qui leur sont propres. Elle s’inscrit dans une démarche intersectionne, féministe et anti-validiste.
Sur la grossophobie

Stigmatiser les gros, c’est mauvais pour tout le monde !, The Conversation, publié le 21 janvier 2019
La grossophobie (stigmatisation des personnes en surpoids) est présente dans toutes les sphères de la société, dont les médias. Les stéréotypes grossophobes sont, non seulement blessants, mais dangereux car ils entraînent des conséquences sur la santé des personnes en surpoids.

« Gros » n’est pas un gros mot. Chroniques d’une discrimination ordinaire, Daria Marx et Eva Perez-Bello du collectif Gras Politique, Flammarion, Librio, collection Idées, 2018 (5€)
Chaque jour, les personnes grosses sont victimes de discriminations, que ce soit pour trouver un travail, pour s’habiller, pour être soignées, pour avoir des enfants, pour être correctement représentées, etc. Les préjugés sur les personnes grosses et les comportements qu’ils entraînent – la grossophobie – peuvent avoir des conséquences dramatiques. Or, la bonne représentation, médiatique notamment, est un facteur participant de l’acceptation des personnes grosses.
Sur le cyberharcèlement
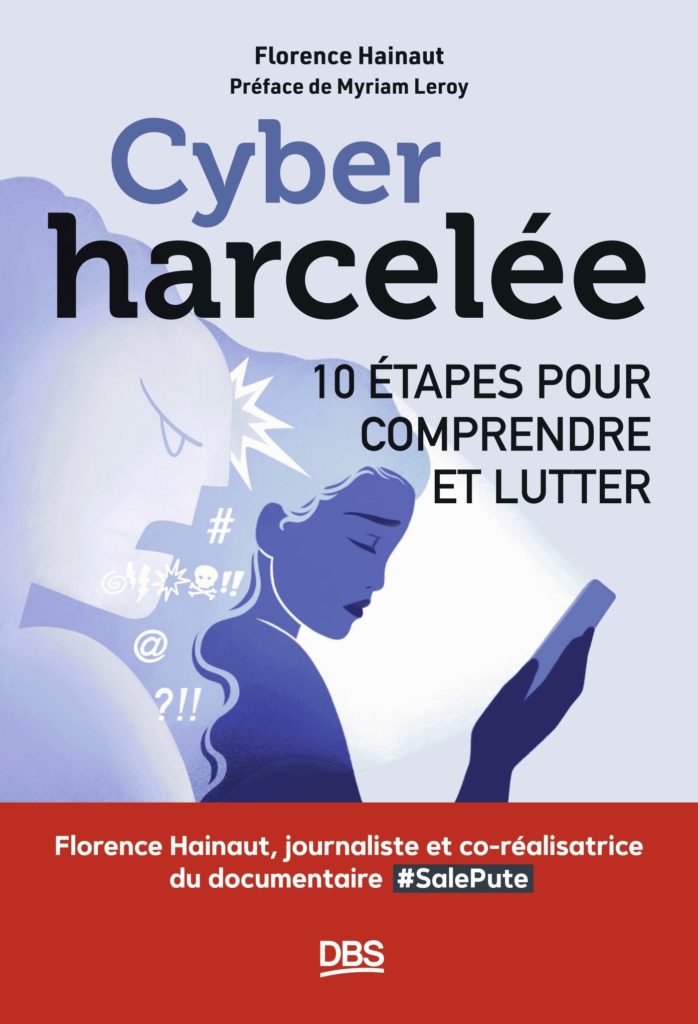
Cyberharcelée : 10 étapes pour comprendre et lutter , Florence Hainaut, éditions De Boeck Supérieur, publié en octobre 2023
85% des filles et des femmes connectées à Internet sont confrontées à des cyberviolences.Trop souvent considéré comme un mal virtuel sans grande importance, le cyberharcèlement a un effet sur presque toutes, anonymes ou figures publiques, avec des séquelles physiques et psychologiques dévastatrices. Pour l’éviter, les femmes se retirent petit à petit du débat démocratique, tant en ligne que hors ligne.
Dans ce livre d’utilité publique, Florence Hainaut nous donne les codes pour comprendre le fonctionnement du cyberharcèlement misogyne et nous livre les clés pour s’en protéger, s’en défendre ou s’en remettre.

The Chilling: A Global Study On Online Violence Against Women Journalists, International Center for Journalists (ICFJ), UNESCO, publié le 2 novembre 2022
Avec le soutien de l’UNESCO, le Centre international des journalistes (ICFJ) a publié une étude mondiale inédite sur la violence en ligne à l’encontre des femmes journalistes, documentant les tendances alarmantes et proposant des solutions à ce problème pernicieux.
Le rapport « The Chilling : Une étude mondiale sur la violence en ligne contre les femmes journalistes » est l’étude la plus diversifiée sur le plan géographique, linguistique et ethnique jamais publiée sur ce thème. La publication de cet ouvrage de 300 pages conclut un projet de recherche de trois ans commandé à l’origine par l’UNESCO en 2019.
Julie Posetti et Nabeelah Shabbir de l’ICFJ, l’étude s’appuie sur les témoignages de plus de 850 femmes journalistes internationales qui ont été interrogées par une équipe de chercheurs internationaux dirigée par la division de la recherche de l’ICFJ.

Manuel de défense contre le cyberharcèlement , PEN America, initialement rédigé en anglais en 2018
Si vous faites face à du harcèlement en ligne, le Manuel de défense contre le cyberharcèlement de PEN America vous propose des conseils pratiques pour vous protéger et vous défendre, pour prendre soin de vous et de votre santé mentale, ainsi que pour soutenir d’autres personnes victimes de cyberharcèlement.
Ce manuel est tout d’abord constitué d’un glossaire du cyberharcèlement. La première étape pour lutter contre le harcèlement en ligne consiste à élaborer un langage commun pour l’identifier et le décrire. De plus, il est une ressource de bonnes pratiques pour les témoins de cyberviolences et les allié·e·s des victimes. Enfin, il édicte 10 bonnes pratiques à mettre en place par les responsables de rédactions pour protéger leurs journalistes.
Ce manuel est aussi disponible en anglais, en espagnol, en arabe et en swahili.

Vu(e)s : combattre le cybersexisme dans le journalisme
Des étudiant∙es de l’IHECS, en master de Communication culturelle et sociale, ont conçu le site Vu(e)s, un outil pédagogique pour accompagner les professeur∙es et élèves de journalisme à explorer collectivement les enjeux du cybersexisme dans le milieu journalistique. Ce site propose animation, ressources concrètes pour (se) protéger contre les cyberattaques misogynes, ainsi que des témoignages sous forme de podcast.
Des rencontres de terrain ont été effectuées, des témoignages ont été récoltés – notamment ceux de l’avocate Audrey Adam et de la journaliste Florence Hainaut – et des outils de sensibilisation, des podcasts et une animation pédagogique ont été développé.
